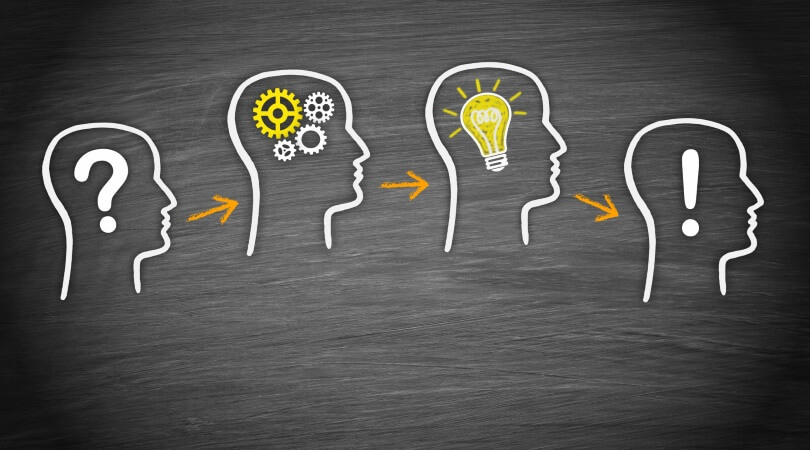Les entreprises sont constamment à la recherche de nouvelles idées, technologies et pratiques pour se démarquer. Pourtant, un obstacle persistant freine souvent l’adoption de solutions externes : le syndrome du « Not Invented Here » (NIH). Ce biais, qui consiste à rejeter ou sous-estimer les innovations provenant de l’extérieur de l’organisation, peut avoir des conséquences majeures sur la performance et la capacité d’adaptation des entreprises.
Comprendre les causes profondes du syndrome NIH, ses manifestations concrètes et ses impacts, est essentiel pour toute organisation souhaitant rester agile et innovante. Cet article propose une analyse approfondie du phénomène, en identifiant ses origines, ses conséquences et en présentant des stratégies éprouvées pour le surmonter.
Comprendre le syndrome du « Not Invented Here »
Définition et origines
Le syndrome du « Not Invented Here » désigne la tendance, consciente ou non, à dévaloriser ou à rejeter les idées, produits ou technologies qui n’ont pas été développés en interne. Il s’agit d’un biais cognitif qui trouve ses racines dans la psychologie humaine : l’attachement à ses propres créations, la valorisation de l’expertise interne, ou encore la peur de perdre le contrôle sur les processus d’innovation.
Sur le plan organisationnel, il peut être renforcé par des structures hiérarchiques rigides, une culture d’entreprise fermée ou des systèmes de reconnaissance qui valorisent avant tout la création interne. Selon Katz et Allen (1982), ce syndrome est particulièrement présent dans les équipes de R&D, où l’identité professionnelle est souvent liée à la capacité d’innover « en interne ».
Manifestations dans les organisations
Le syndrome « Not Invented Here » se manifeste de plusieurs façons dans les entreprises.
Parmi les exemples les plus courants, on trouve le rejet systématique de solutions logicielles ou technologiques développées par des tiers, la préférence pour le développement « maison » même lorsque des alternatives éprouvées existent, ou encore la réticence à collaborer avec des partenaires externes.
Certains secteurs sont particulièrement touchés, notamment l’industrie pharmaceutique, l’aéronautique ou encore les technologies de l’information, où la propriété intellectuelle et la maîtrise des processus sont perçues comme des avantages compétitifs majeurs. Par exemple, de nombreuses entreprises informatiques ont longtemps préféré développer leurs propres outils de gestion de projet, malgré l’existence de solutions performantes sur le marché, par crainte de dépendre d’un fournisseur externe.Causes du syndrome « Not Invented Here »
Facteurs psychologiques
La fierté professionnelle et le sentiment de compétence jouent un rôle central dans l’émergence du syndrome. Les équipes internes peuvent percevoir l’adoption de solutions externes comme une remise en question de leur expertise ou de leur légitimité. La peur de la perte de contrôle, ou encore la crainte de diluer l’identité de l’entreprise, sont également des facteurs psychologiques importants.
Facteurs organisationnels
La culture d’entreprise est un levier puissant. Une organisation qui valorise l’autosuffisance et la confidentialité aura tendance à favoriser le développement interne, même au détriment de l’efficacité. Les systèmes de récompense et de reconnaissance, qui privilégient les innovations « faites maison », renforcent ce biais. Selon Antons et Piller (2015), la structure des incitations internes peut expliquer en grande partie la persistance du syndrome NIH.
Facteurs structurels
Le manque de processus formalisés pour intégrer l’innovation externe constitue un frein majeur. L’absence de veille technologique, de benchmarking ou de procédures d’évaluation des solutions externes limite la capacité de l’organisation à identifier et à adopter des innovations pertinentes. Par ailleurs, des problèmes de communication, tant en interne qu’avec l’extérieur, peuvent accentuer l’isolement et la méfiance vis-à-vis des apports extérieurs.
Conséquences du syndrome
Frein à l’innovation
Le principal risque du syndrome « Not Invented Here » est de ralentir, voire d’entraver l’innovation. En refusant d’adopter des technologies ou des pratiques développées ailleurs, l’entreprise s’expose à un retard technologique et à une perte d’opportunités de marché. Lichtenthaler et Ernst (2006) soulignent que les organisations les plus fermées sont aussi celles qui innovent le moins rapidement.
Coûts supplémentaires
Il entraîne souvent une duplication des efforts de R&D : des ressources précieuses sont mobilisées pour réinventer des solutions déjà existantes. Cela se traduit par une augmentation des coûts de développement, une allocation inefficace des budgets et, parfois, des retards dans la mise sur le marché de nouveaux produits.
Impact sur la collaboration
Enfin, il complique la mise en place de partenariats externes, qu’il s’agisse de collaborations avec des startups, des laboratoires de recherche ou d’autres entreprises. Cette fermeture peut conduire à un isolement organisationnel, limitant l’accès à des réseaux d’innovation et à des compétences complémentaires.
Stratégies pour surmonter le syndrome « Not Invented Here »
Favoriser une culture d’ouverture
La première étape consiste à promouvoir une culture d’ouverture et de curiosité. Cela passe par la valorisation de l’apprentissage externe, la reconnaissance des apports extérieurs et la mise en avant de réussites issues de l’intégration de solutions externes. Par exemple, certaines entreprises organisent des « Innovation Days » où des fournisseurs et partenaires viennent présenter leurs dernières avancées.
Mettre en place des processus d’intégration
L’instauration de processus formalisés de veille technologique et de benchmarking permet d’identifier les meilleures pratiques et innovations disponibles sur le marché. Il est également crucial de mettre en place des procédures d’évaluation et d’adoption des solutions externes, en impliquant les équipes concernées dès le début du processus.

Former et sensibiliser les équipes
La formation sur les biais cognitifs, et en particulier sur le syndrome NIH, aide à prendre conscience des mécanismes psychologiques à l’œuvre. Des témoignages et retours d’expérience d’équipes ayant réussi à intégrer des innovations externes peuvent servir de leviers de changement. Par exemple, chez Procter & Gamble, le programme « Connect + Develop » a permis de sensibiliser les équipes à l’intérêt de l’innovation ouverte, avec des résultats probants.
Adapter les systèmes de récompense
Enfin, il est essentiel d’adapter les systèmes de reconnaissance pour valoriser non seulement la création interne, mais aussi l’adoption efficace de solutions externes. Récompenser la collaboration inter-organisationnelle et l’intégration réussie d’innovations extérieures envoie un signal fort à l’ensemble de l’organisation.
Etudes de cas et exemples concrets
Plusieurs entreprises ont su surmonter le syndrome NIH avec succès. Un exemple emblématique est celui de Procter & Gamble, qui, au début des années 2000, a radicalement transformé sa stratégie d’innovation en lançant le programme « Connect + Develop ». Constatant que 50% de ses innovations provenaient de l’extérieur, l’entreprise a mis en place des processus pour identifier, évaluer et intégrer les idées externes, tout en valorisant les équipes qui réussissaient à collaborer avec des partenaires.
Autre exemple, General Electric a développé des plateformes d’innovation ouverte permettant à des startups et des chercheurs externes de proposer des solutions à des défis technologiques précis. Cette démarche a permis à GE d’accélérer le développement de nouveaux produits tout en réduisant les coûts de R&D.
Ces succès reposent sur plusieurs facteurs : une volonté forte de la direction, la mise en place de processus adaptés, et une évolution de la culture d’entreprise vers plus d’ouverture et de collaboration.
Le syndrome du « Not Invented Here » constitue un frein majeur à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. Ses causes sont multiples : psychologiques, organisationnelles, structurelles. Ses conséquences peuvent être lourdes, tant en termes de coûts que d’agilité. Pourtant, des solutions existent : promouvoir une culture d’ouverture, formaliser l’intégration de l’innovation externe, former les équipes et adapter les systèmes de reconnaissance.
Pour les dirigeants et managers, il s’agit d’un enjeu stratégique : seule une organisation capable de s’ouvrir à l’extérieur, d’apprendre et d’intégrer le meilleur de ce qui existe, pourra rester compétitive dans un environnement en perpétuelle évolution. L’appel à l’action est clair : il est temps de dépasser le syndrome NIH pour libérer tout le potentiel de l’innovation ouverte.

FAQ – Syndrome « Not Invented Here » (NIH)
Qu’est-ce que le syndrome « Not Invented Here » (NIH) ?
Le syndrome NIH désigne la tendance d’une organisation à rejeter ou sous-estimer les idées, solutions ou innovations provenant de l’extérieur, préférant développer ses propres solutions internes.
Le syndrome NIH est-il universel ?
Non, il varie selon les cultures nationales et sectorielles. Par exemple, certaines entreprises japonaises privilégient l’innovation interne, tandis que les entreprises nord-américaines sont souvent plus ouvertes à l’innovation externe.
Quels sont les risques liés à l’intégration de solutions externes ?
L’innovation externe comporte des risques tels que des problèmes d’interopérabilité, une dépendance vis-à-vis de partenaires, et une dilution de la culture d’entreprise.
Quelles sont les causes principales du syndrome NIH ?
Outre la peur de perdre le contrôle, la protection de la propriété intellectuelle et la confidentialité jouent un rôle important, notamment dans les secteurs sensibles comme la défense ou la pharmacie.
Existe-t-il des exemples concrets d’échecs liés au syndrome NIH ?
Oui, l’exemple de Kodak, qui n’a pas su adopter la photographie numérique développée en externe, illustre les conséquences négatives du syndrome NIH.
Quelles sont les recommandations pour surmonter le syndrome NIH ?
- Mettre en place des indicateurs de performance pour l’intégration externe,
- Utiliser des plateformes d’innovation collaborative,
- Organiser des ateliers de co-création avec des partenaires externes.
Surmonter le syndrome NIH signifie-t-il abandonner l’innovation interne ?
Non, il s’agit plutôt de compléter l’expertise interne par des apports externes.
Pourquoi est-il stratégique de dépasser le syndrome NIH ?
Les organisations capables d’articuler efficacement innovation interne et externe seront plus compétitives et résilientes face aux évolutions du marché.